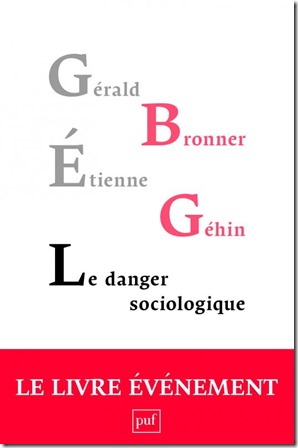De Vianney, cette note de lecture publiée sur le site "Des hauts et débats" :
Note de lecture : Le danger sociologique
L’ouvrage et les auteurs
Etienne Géhin est présenté sur la couverture comme un (ex) maître de conférences en sociologie. Avant cela, je n’avais jamais entendu parler de lui ; Gérald Bronner, en revanche, est plus connu du grand public, notamment pour ses analyses de la radicalisation et des théories du complot. Il a acquis récemment une notoriété médiatique relativement importante pour un sociologue.
Le contenu du livre
Le livre est un véritable plaidoyer pour la sociologie analytique, aussi appelée individualiste, ou encore compréhensive. Même s’il constitue une charge contre la sociologie holiste (ou structuraliste, ou culturaliste), le ton adopté n’a rien d’un pamphlet, comme certains médias l’ont prétendu (Le Monde, Les Inrocks). Il est plutôt constructif et adopte résolument une posture scientifique (la liste des références est assez fournie).
Une approche ouverte des phénomènes sociaux
Le point le plus positif du livre, c’est l’approche pluridisciplinaire assumée. Elle est particulièrement réjouissante. Le livre puise abondamment dans les sciences cognitives (psychologie et neurosciences) et fait parfois appel à quelques raisonnements économiques. Cela est réjouissant parce qu’un authentique esprit scientifique doit s’attacher à remettre sans cesse sur le métier la seule question fondamentale des sciences de l’homme : comment expliquer le comportement humain ? Comment aujourd’hui peut-on se tenir par principe à une seule approche (expliquer le social par le social, cf. Durkheim), expliquer tous les phénomènes avec seulement un ou deux concepts et adopter une posture de cloisonnement disciplinaire ? Plusieurs approches (et donc plusieurs sciences) peuvent être fructueuses et complémentaires pour expliquer le comportement humain. La posture de cloisonnement disciplinaire et ses querelles de chapelle est donc particulièrement insupportable tant elle dessert la quête scientifique. Comment un sociologue n’ayant qu’une vague formation économique peut-il encore ressortir le vieux cliché de “l’homo oeconomicus” froid et calculateur, sans aucune connaissance des multiples travaux existant depuis des décennies dans le domaine de la psychoéconomie, de la théorie des jeux, qui ont longuement nuancé, précisé, approfondi le modèle classique de la rationalité ? C’est une simple question de décence intellectuelle : quand on ne sait pas, on se tait. Ici, le « danger sociologique » dénoncé par Bronner et Géhin est clairement le danger idéologique : au nom de certains principes, de certaines valeurs ou d’une position épistémologique relativiste (la vérité objective ne serait que la reproduction historique du discours dominant), la sociologie perd en scientificité. Le livre évoque à ce sujet (pour la critiquer) la pétition signée par certains chercheurs contre l’introduction à l’école de cours sur les théories du complot contre la « volonté de normalisation et l’injonction d’enseigner à tous comment penser droit ».Autre exemple, la défiance de principe d’une large partie des sociologues envers les sciences de la nature parce qu’utiliser des raisonnements issus des neurosciences serait “naturaliser” le comportement humain, donc constituerait une régression intellectuelle par rapport à une sociologie se devant d’être conçue pour expliquer que “tout est construit”. L’enjeu ici est tout à fait politique : si “tout est construit”, tout peut être déconstruit (et reconstruit), donc sauver le progressisme nécessiterait de lutter contre la “naturalisation” des comportements humains, ce qui serait le travail propre de la sociologie. Bronner et Géhin ont parfaitement raison de souligner qu’en plus d’être une posture de principe, cette position confond hâtivement déterminisme génétique et support biologique. Nos comportements prennent indubitablement leur source dans notre organisme, à commencer par le siège des décisions, le cerveau ; de fait, il est tout à fait réducteur de prétendre expliquer le comportement humain sans comprendre le corps humain, par qui s’opèrent toutes les décisions humaines. Pour le dire autrement, toute action et toute pensée a des fondements matériels. Pour autant, cela ne veut pas dire que ces fondements matériels induisent une hérédité génétique, comme si l’on pouvait par exemple trouver le « gène de l’homosexualité ». Ma pensée vient de mon cerveau : en ce sens, je suis le produit d’un ensemble de ressources organiques. Mais cela ne veut pas dire pour autant que tous mes comportements sont hérités : biologique et inné sont deux choses différentes. On peut donc parfaitement sauver le progressisme tout en acceptant la biologie. De toute façon, la biologie existe, et elle a une notoriété scientifique bien plus importante que la sociologie : qu’ont donc à gagner les sociologues en ignorant des travaux souvent considérés comme plus objectifs que les leurs, à part une décrédibilisation supplémentaire ?
Un exemple avec le concept d’habitus
Prenons le concept bourdieusien d’habitus, discuté dans le livre. Le terme grec signifie “manière d’être” et correspond à l’ensemble des dispositions durables acquises par la socialisation. Bourdieu comparait l’habitus a un programme informatique et jugeait qu’il expliquait les manières de voir, de penser, de faire, les goûts et les couleurs (cf. La Distinction, 1979), etc. L’habitus politique des individus peut par exemple expliquer pourquoi, si seuls les catholiques pratiquants avaient voté au premier tour de la présidentielle 2017, François Fillon aurait été élu dès le premier tour. Tout en critiquant le concept, Bronner et Géhin estiment qu’on peut le garder si on l’associe aux sciences cognitives en présentant l’habitus comme un ensemble de routines mentales acquises et ancrées dans le cerveau. On sait en effet que le cerveau est plastique. Un chauffeur de taxi va donc développer certaines aires comme celle du repérage dans l’espace. L’habitus correspondrait ainsi à des habitudes durablement acquises et matériellement intégrées sous forme de réseaux de neurones. L’intérêt de cette association est de sauver un concept intéressant et qui a indéniablement un pouvoir explicatif, mais à qui certains sociologues ont eu tendance à faire dire tout et n’importe quoi, sans qu’on puisse dire exactement à quoi correspond l’habitus, Bourdieu en ayant lui-même donné des définitions variées et souvent floues. A l’ère de l’épigénétique, la vieille distinction acquis/inné semble dépassée. L’habitus est fondamentalement acquis, car il est transmis et modelé continûment par la socialisation dans des groupes sociaux divers, c’est-à-dire dans une culture ; mais il est aussi inné au sens où il se matérialise par des réseaux de neurones spécifiques, des routines de pensée avec un fondement neural.
Quel niveau de détail analytique ?
Le Danger sociologique constitue un plaidoyer pour la sociologie individualiste ce qui renvoie aussi au choix du niveau de détail dans l’analyse. S’ils font appel à beaucoup de travaux psychologiques, Bronner et Géhin admettent que trop près de l’individu, la sociologie n’est plus qu’une succursale de la psychologie, et perd son caractère propre d’explication des phénomènes sociaux, donc collectifs.Cependant, trop loin de l’individu et le sociologue aura tendance, selon Bronner et Géhin, à déformer la réalité par l’utilisation excessive des statistiques macrosociologiques. Reprenons l’exemple du vote catholique (cet exemple n’est pas dans le livre, mais je trouve qu’il est assez parlant pour la discussion méthodologique). On peut prédire assez facilement, au niveau macrosociologique, le choix des catholiques pratiquants à partir des statistiques de la science politique et des analyses basées sur l’habitus catholique. Pour autant, dire que le capital culturel des catholiques pratiquants est tel que Fillon l’aurait emporté au premier tour si eux seuls avaient voté ne rend pas raison de toutes les opérations mentales qu’un catholique pratiquant réalise avant de se décider. En observant le résultat final (la majorité des catholiques pratiquants ont voté Fillon, donc Fillon est le choix des catholiques), le sociologue agrège une myriade de microdécisions individuelles, d’opérations mentales diverses et parfois contradictoires. Deux individus catholiques peuvent voter Fillon mais fort différemment : après avoir longuement hésité ou sans hésitation, avec enthousiasme ou avec défiance, par défaut ou par adhésion, par rejet ou par principe, etc. La phrase “l’électoral catholique vote Fillon” agrège artificiellement une myriade de microdécisions individuelles comme s’il y avait une entité abstraite, “le” catholique, ayant “un” habitus qui le fait voter Fillon.Ainsi, Bronner et Géhin critiquent notamment Durkheim quand il développe l’idée qu’il existe des structures indépendantes des individus qui ont comme une existence propre. Ils s’inscrivent ici dans la tradition nominaliste (Hayek est plusieurs fois cité) : les agrégations (“l’Etat”, “la religion”, “la classe”, “la culture”, “la paysannerie”…) ne sont que des regroupement pratiques pour l’étude ou le langage, mais ne désigne pas des réalités ontologiques. Cela ne signifie pas pour autant que le tout n’est que la somme des parties individuelles, dans une phraséologie un peu libérale-naïve, car les agrégations individuelles peuvent donner des résultats collectifs non voulus par les acteurs. Ainsi d’un ensemble d’épargnants qui courent à la banque pour retirer leurs avoirs, précipitant la faillite de la banque.Je dois dire que je partage assez l’analyse des auteurs sur ce point. La tentation est toujours forte, pour le sociologue, d’attribuer des pouvoirs causaux à des entités jamais clairement définies (“le corps social”, “l’électorat”, …) et que personne n’a observé empiriquement. Si les données macrosociologiques sont indispensables, les sociologues en tirent parfois des conclusions excessives qui ne rendent pas raison des choix individuels et in fine qui n’expliquent pas suffisamment bien les phénomènes sociaux. Observer les effets des structures sur les individus et les structures elles-mêmes n’est pas la même chose. De ce point de vue, le livre constitue aussi un plaidoyer pour la sociologie expérimentale ; rien n’est plus nuisible à la sociologie que l’excès de conceptualisation qui étouffe le travail empirique. C’est particulièrement vrai à l’ère du BigData 2.0, comme le soulignent les auteurs à la fin du livre :
L’apparition d’Internet et, notamment, celle du web 2.0 permet aux chercheurs de recueillir de nouvelles traces de l’activité sociale qui demeuraient auparavant plus ou moins invisibles. Les sciences sociales, comme toutes les disciplines scientifiques, cherchent à recueillir et à interpréter des traces laissées dans le réel, et qui sont décelables par des dispositifs méthodologiques (analyse d’archives, entretiens, enquêtes quantitatives, observations, etc.). La disponibilité de ces traces est donc la condition nécessaire – mais non suffisante – du succès de l’entreprise scientifique en général. L’accroissement de cette disponibilité pourrait être une formidable opportunité pour la sociologie, mais ce que l’on observe présentement est plutôt le développement exponentiel de publications qui relèvent de la web science (Hendler et al. 2008) ou de la new science of networks (Watts, 2004). Ces nouvelles approches sont essentiellement le fait des informaticiens, des physiciens ou des mathématiciens. Un regard statistique sur ces nombreuses publications montre que les sociologues n’en sont pas souvent les auteurs, alors que les objets sur lesquels portent ces articles (mouvements d’opinion, croyances, rumeurs, activisme) relevaient habituellement de leurs compétences.
Comprendre les phénomènes sociaux, c’est comprendre les choix des individus, même agrégés en collectifs : Bronner et Géhin assument une filiation wébérienne qui a l’avantage de ne pas juger à l’avance des décisions individuelles. Ce qui nous paraît absurde (se suicider à l’aide d’une bombe, par exemple) n’est peut être pas irrationnel pour tel ou tel sujet. Il est plus scientifique de comprendre les logiques individuelles plutôt que de supposer qu’il existerait des entités mystérieuses (“le” groupe, “l’Etat”, “la” religion…) qui gouverneraient les individus comme des pantins. Surconceptualisée et trop loin de la décision individuelle, la sociologie se transforme alors en une mauvaise prose de philosophie militante, car « élaborer une théorie sociologique très compliquée, abusant du name-droping et du concept-droping, c’est-à-dire créer un écran de fumée, n’est pas difficile » (Nicolas Walzer). C’était d’ailleurs le cas de Bourdieu à la fin de sa vie. Qui plus que lui a fait usage de la violence symbolique en produisant des textes inutilement complexes, avec un vocabulaire volontairement abscons, à peine lisible ? Qu’on pense par exemple à la définition de l’habitus qu’il donne en 1980 :
Les conditionnements associés à une classe particulière de conditions d’existence produisent des habitus, systèmes de dispositions durables et transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de pratiques et de représentations qui peuvent être objectivement adaptées à leur but sans supposer la visée consciente de fins et la maîtrise expresse des opérations nécessaires pour les atteindre, objectivement réglées et régulières sans être en rien le produit de l’obéissance à des règles, et, étant tout cela, collectivement orchestrées sans être le produit de l’action organisatrice d’un chef d’orchestre.
Quelques remarques critiques
A la page 177, on trouve cette phrase : « Nous ne faisons que nous interroger sur la fiction intellectuelle la plus efficace pour rendre compte des phénomènes qui intéressent la sociologie ». Le terme “fiction intellectuelle” est particulièrement intéressant car il rappel que toute analyse scientifique de la réalité doit s’appuyer sur un modèle ; tout modèle est simplificateur. La seule question qui vaille est de savoir si le modèle est suffisamment réaliste et donc suffisamment prédictif par rapport à la réalité du phénomène traité.Or, à ce niveau, le livre est un peu décevant. En effet, même s’ils s’en défendent, Bronner et Géhin semble souvent essayer de sauver par principe le concept d’acteur autonome et de libre-arbitre, sans que cela soit toujours rigoureusement justifié. Certains passages donnent l’impression d’assister à une guerre de valeurs plutôt qu’à une guerre des méthodes, pourtant défendue par les auteurs. Je pense par exemple aux passages sur la déviance et où les exemples cités (le capitaine du Costa Concordia) ne semblent pas très convaincants. Dire qu’il existe des écarts à la norme et une distance par rapport aux rôles sociaux (tout rôle social est interprété, disait Goffman) ne signifie pas ipso facto que l’acteur autonome existe. Certes, le fait que Francesco Schettino se soit comporté à l’exact opposé de ce que son rôle social prescrivait de lui à cet instant prouve que tout ne peut pas être prédit dans une situation donnée. Mais les sociologues mêmes structuralistes n’ont jamais nié qu’un même habitus permettait de faire face à des situations différentes (et d’adopter une certaine gamme d’actions), ni Bourdieu, encore moins Lahire (abondamment critiqué par Bronner et Géhin) qui a développé le concept “d’Homme pluriel”.Je cite par exemple Bourdieu en 1978, c’est moi qui souligne :
Principe d’une autonomie réelle par rapport aux déterminations immédiates par la « situation », l’habitus n’est pas pour autant une sorte d’essence anhistorique dont l’existence ne serait que le développement, bref un destin une fois pour toutes défini.Les ajustements qui sont sans cesse imposés par les nécessités de l’adaptation à des situations nouvelles et imprévues, peuvent déterminer des transformations durables de l’habitus, mais qui demeurent dans certaines limites : entre autres raisons parce que l’habitus définit la perception de la situation qui le détermine. (…) Et de fait, l’habitus est un capital, mais qui, étant incorporé, se présente sous les dehors de l’innéité. Mais pourquoi ne pas avoir dit habitude ? L’habitude est considérée spontanément comme répétitive, mécanique, automatique, plutôt reproductive que productrice. Or, je voulais insister sur l’idée que l’habitus est quelque chose de puissamment générateur. L’habitus est, pour aller vite, un produit des conditionnements qui tend à reproduire la logique objective des conditionnements mais en lui faisant subir une transformation ; c’est une espèce de machine transformatrice qui fait que nous « reproduisons » les conditions sociales de notre propre production, mais d’une façon relativement imprévisible, d’une façon telle qu’on ne peut pas passer simplement et mécaniquement de la connaissance des conditions de production à la connaissance des produits.
On peut très bien sauver le structuralisme et la déviance en disant, comme Lahire, que l’individu est pris dans des structures différentes et parfois contradictoires (socialisation contradictoire) et que, dès lors, “son stock de dispositions, d’habitudes ou de capacités ne sera pas unifié. Il aura en conséquence des pratiques hétérogènes ou contradictoires, variant selon le contexte social. C’est ce que l’on observe souvent lors de l’entrée en couple ou de l’apparition du premier enfant. Certaines femmes, qui avaient adopté le style de vie d’une femme « moderne » et « émancipée », retrouvent à cette occasion ce rôle traditionnel de la femme au foyer dont elles avaient incorporé les habitudes sans toujours s’en rendre compte. La même personne se trouve ainsi porteuse d’au moins deux schémas d’action domestique. En fonction du mode d’interaction instauré avec le conjoint, l’un des deux schémas est activé et l’autre mis en veille” (cf. Lahire, 2010). Écrire que 83% des individus ne commettent pas de délits à St Denis contre 92% à Annecy, ce qui constitue au fond une différence mineure, ne permet pas pour autant de mettre à bas l’affirmation selon laquelle les structures sociales sont des facteurs de délinquance, c’est-à-dire que la culture des individus à St Denis et celle à Annecy, fort différente, structure les comportements individuels dans une situation donnée.Pour en revenir à la biologie, on sait aujourd’hui qu’une grande partie de nos opérations mentales sont inconscientes (notre cerveau travaille sans que cela soit le fruit d’un choix mental délibéré). Le cerveau est soumis à certains automatismes. Certains d’entre eux sont parfaitement inévitables et universels (les illusions d’optique, les rêves, le fait d’être droitier ou gaucher, les réflexes…). D’autres varient selon les individus, mais sont très difficiles à contrôler pour eux (le vertige, par exemple). Le fonctionnement même du cerveau, étudié par les neurosciences, suggère que de nombreuses réactions ne parviennent pas à notre conscience. Il est difficile d’éviter les biais cognitifs. Votre cerveau verra passer une image subliminale, mais pas vous. Une partie de vos pensées vous échappent. Curieux paradoxe, pourtant au cœur de l’architecture cérébrale des êtres humains : pendant que vous êtes occupés à penser un (et souvent, un seul) objet mental, votre cerveau continu de réaliser de nombreuses opérations. Quelle est la part de vos opérations cérébrales qui échappent à votre conscience ? Il ne s’agit pas de donner une réponse en pourcentage, mais en l’état actuel des connaissances neuroscientifiques, on peut répondre qu’il y a bien plus d’inconscient que de conscient. Cela peut avoir de réelles conséquences pénales : d’après l’AFIS (lien supra), en 1995, un officier de police de Boston, Kenneth Conley, avait été accusé de faux témoignage pour avoir déclaré ne pas avoir vu une agression violente, survenue pendant qu’il poursuivait un suspect. En 2011, Chabris et Simons montrèrent, par une série d’expériences menées avec leurs étudiants et reproduisant cette situation, qu’il était possible que Conley n’ait réellement pas vu la bagarre, parce que son attention était concentrée sur une autre tâche. Le policier fut alors réintégré dans ses fonctions.Faut-il en conclure que l’individu n’est pas autonome ? J’ai le sentiment que l’opposition des concepts (conscient/inconscient, autonome/hétéronome, libre-arbitre/déterminisme) est parfois un peu artificielle dans le livre. Bourdieu prenait souvent la métaphore du piano : l’individu a tellement travaillé ses gammes (ie. incorporé un habitus) qu’il joue de manière non consciente au sens où il ne réfléchit pas avant de jouer mais ça n’est pas pour autant un automate déterminé par on ne sait quelle machine. Encore une fois, dire que nous avons une base neurale qui travaille en permanence en dehors de notre accès conscient ne signifie pas que nous n’avons pas de choix à faire, et que la sociologie ne peut pas étudier ces choix. En biologie, l’existence même du cerveau signifie que nos contenus mentaux sont déterminés par la chimie cérébrale. Cette chimie cérébrale détermine le cadre dans lequel s’opère les opérations mentales. Cela n’enlève en rien la possibilité d’actions conscientes et volontaire. Suis-je moins libre parce que je n’ai pas choisi la loi de la gravitation, le poids des atomes ou les caractéristiques de mes gènes ? La loi de la gravitation s’impose à moi comme à tous les autres : ce n’est pas une loi que je puisse violer. On n’obéit pas aux lois de la nature comme on obéit au code de la route : le terme « obéir » est impropre car les lois de la nature sont en réalité des modèles décrivant la façon dont les phénomènes naturels influencent mes actions, le cadre dans lequel s’exerce ma volonté. Violer une loi de la nature en ce sens signifierait en réalité que la loi ne décrit pas aussi bien nos actions qu’on le pensait : la « loi » est fausse et on la change.Le concept de libre-arbitre ne peut donc pas s’appliquer à ce qu’on appelle les « lois de la nature ». Je n’ai pas choisi d’avoir un ADN, mais ce n’est pas une caractéristique que je peux changer. Il n’y a pas d’alternatives. Les lois de la génétiques sont une description de la façon dont les parents transmettent (par exemple) la couleur de leur peau à leurs enfants, un cadre scientifique explicatif, et jusqu’à preuve du contraire il n’en est pas autrement. Dire que je ne suis pas libre parce que je ne peux pas agir sur ce cadre est une mauvaise conception de la liberté, une conception idéaliste, réifiée, selon laquelle la liberté est un pur concept, quelque chose d’immatériel qui s’exerce dans un cadre indéterminé. Si chacun pouvait « choisir » la vitesse de la lumière, cela signifierait qu’il n’y a pas de vitesse de la lumière, donc pas de cadre dans lequel j’exerce ma volonté, qui permette de lui donner une réalité tangible.Au final, la charge de Bronner et Géhin contre la sociologie structuraliste (et Lahire en particulier) m’a paru excessive. Quand les sociologues choisissent un modèle explicatif structuraliste, ils ne prétendent pas pour autant que l’individu n’a aucun choix à faire, qu’il n’est qu’un pantin articulé. Lahire écrivait d’ailleurs en 2010 (je souligne) :
On peut donc faire l’hypothèse de l’incorporation, par chaque acteur, d’une multiplicité de schèmes d’action ou d’habitudes. Ce stock de modèles, plus ou moins étendu selon les personnes, s’organise en répertoires, que l’individu activera en fonction de la situation. (…) On a tendance à considérer, dans une société différenciée, l’homogénéité des dispositions de l’acteur comme la situation modale et la plus fréquente. Il nous semble qu’en réalité cette situation est la plus improbable et la plus exceptionnelle. Il est beaucoup plus courant en effet d’observer des individus porteurs d’habitudes disparates et opposées. L’homme pluriel est la règle plutôt que l’exception. (…) Tant que la sociologie se contentait d’évoquer l’acteur individuel à propos d’un champ de pratiques singulier, elle pouvait faire l’économie de l’étude des logiques sociales individualisées. Mais dès lors que l’on privilégie l’individu (non comme atome et base de toute analyse sociologique mais comme le produit complexe de multiples processus de socialisation), il n’est plus possible de se satisfaire des modèles d’action utilisés jusque-là. La sociologie psychologique, qui entend saisir l’individu sur des scènes et dans des contextes différents, prend à bras-le-corps la question de la réalité sociale sous sa forme individualisée et intériorisée.
Un paragraphe que ne renieraient sans doute pas Bronner et Géhin.
Conclusion
Je serai bref, car je ferais la même conclusion que Nicolas Walzer : on peut souhaiter qu’il naisse un débat serein et passionnant de cet ouvrage, plutôt que les querelles d’égos et de courants auxquels les sociologues nous ont trop souvent habitués.